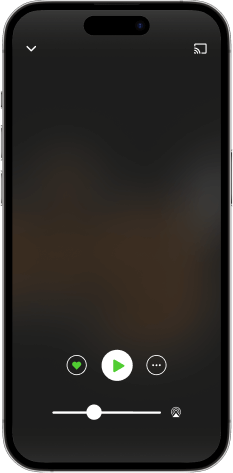La mer d’Aral, autrefois l’un des plus grands lacs du monde, est aujourd’hui l’un des plus grands désastres écologiques causés par l’homme. Située en Asie centrale, à cheval entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, cette mer intérieure a commencé à se réduire drastiquement à partir des années 1960, en grande partie à cause des décisions prises par l’Union soviétique. Mais pourquoi l’URSS a-t-elle asséché la mer d’Aral ?
Tout remonte aux années 1950, lorsque les dirigeants soviétiques ont lancé un ambitieux programme de développement agricole. L’objectif était de transformer l’Asie centrale en un immense grenier à coton, surnommé "l’or blanc", pour répondre aux besoins croissants de l’économie soviétique. Pour irriguer ces vastes plantations de coton, l’URSS a détourné les deux principaux fleuves qui alimentaient la mer d’Aral : l’Amou-Daria et le Syr-Daria. Des milliers de kilomètres de canaux d’irrigation ont été construits, souvent de manière peu efficace, avec d’importantes pertes d’eau par infiltration et évaporation.
À court terme, cette politique a permis une augmentation massive de la production agricole, rendant l’Union soviétique autosuffisante en coton et renforçant son économie. Cependant, les conséquences écologiques n’ont pas tardé à apparaître. Privée d’une grande partie de son alimentation en eau douce, la mer d’Aral a commencé à se rétrécir rapidement, perdant environ 90 % de sa superficie en quelques décennies.
Les répercussions de cet assèchement ont été catastrophiques. La salinité de l’eau a fortement augmenté, rendant impossible la survie de nombreuses espèces aquatiques. Les ports autrefois prospères sont aujourd’hui des cimetières de bateaux échoués dans le désert. Le climat local s’est également détérioré, avec des hivers plus froids et des étés plus chauds, accentuant les difficultés agricoles.
De plus, les sédiments exposés, chargés de pesticides et de produits chimiques utilisés autrefois pour l’agriculture intensive, ont été soulevés par le vent, provoquant des problèmes de santé majeurs parmi les populations locales, comme des maladies respiratoires et des cancers.
Aujourd’hui, des efforts sont entrepris pour restaurer partiellement la mer d’Aral, notamment par le Kazakhstan, qui a construit un barrage pour préserver sa partie nord. Toutefois, la majeure partie de l’ancien bassin est irrémédiablement perdue, laissant derrière lui une leçon amère sur les conséquences d’une gestion non durable des ressources naturelles.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.